Le droit canon distingue deux types
d’empêchement au mariage :
*DIRIMANT (dirimer empêcher un contrat)
interdit totalement le mariage à la personne
concernée (folie, polygamie, l’impuberté)
*PROHIBITIF
ne rend pas le mariage impossible mais constitue un
péché.
Le droit canon interdit le mariage avec
certaines personnes :
*PARENTE NATURELLE
jusqu’au quatrième degré. Pour éviter la
transmission de tares ou de maladies héréditaires. Plus connu sous le nom de
« degré de consanguinité »
*PARENTE par ALLIANCE ou AFFINITE
jusqu’au quatrième degré. Tous les parents du mari
sont les « affins » de sa femme et réciproquement
*PARENTE CIVILE
entre le père et la fille adoptive
*PARENTE SPIRITUELLE
entre le parrain et la filleule par exemple
Il
était possible d’obtenir une dispense. Les
demandes étaient déposées
auprès de l’officialité (tribunal
ecclésiastique) du
diocèse auquel on appartenait, avant
d’être introduits en Cour de Rome.
RELIGION
DIFFERENTE
Ne
constituait pas une cause d’empêchement au mariage, jusqu’à un édit de Louis
XIV qui l’interdit formellement en novembre 1680.
QUELQUES
DATES
Au début du Moyen-Âge, le mariage n’est pas sacré et les contrats écrits tombent en désuétude. Le mariage permet de sceller les alliances.
805
L’église rend obligatoire le passage devant un
prêtre. Cependant, quelques années plus tard, la présence de seuls témoins
laïcs est acceptée.
1215
Lors du 5ème concile du Latran, le
mariage devient un sacrement.
1263
L’église confirme le statut de sacrement au mariage.
Sous la pression de l’église, le divorce est interdit (Concile de Trente).
Mai 1579
Henri III impose la tenue des registres de mariage.
La filiation est mentionnée
Après la Révolution la filiation n’est plus
mentionnée
20 août 1897
mention du mariage en marge de l’acte de mariage
7 décembre 1897
les femmes peuvent êtres témoins au mariage
1927
les registres de publications de mariage peuvent
être détruits
PUBLICATIONS DE
MARIAGE
Elles permettent de situer un mariage célébré en dehors de la commune. Une circulaire
ministérielle du 25 juin 1927 autorise la destruction des registres.
Le 8 avril 1927, les registres sont supprimés. Ils sont remplacés par une affiche de publication. Ces documents sont détruits un an après.
LOI DU 13 FRUCTIDOR AN VI
(30
août 1798)
Cette
loi demande que les mariages soient célébrés aux chef-lieux des districts et
seulement les décadis (dixième jour de la décade républicaine). Il est tenu un
registre distinct.
Cette loi sera appliquée jusqu’au 26 juillet 1800.
Le 18 pluviôse an VIII un décret rétabli
l’enregistrement des actes dans les communes.
MAJORITE POUR LE
MARIAGE
Du XVIème au XVIIIème siècles, la femme a entre 13 et 25 ans, l’homme a entre 15 et 30 ans.
- L’âge minimum à la royauté : 13 ans pour les filles et 15 pour les garçons.
- L’âge minimum à la Révolution : 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons.
- L’âge minimum pour le Code Napoléon : 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons.
- L’âge minimum pour le Code canonique (1883) : 13 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons, mais en France c’est le Code Civil qui s’applique.
Jusqu’au XVIIème siècle, le consentement des parents n’était pas obligatoire.
Le consentement est codifié et exigé par le Concile de Trente (1563) et l’Edit de Blois (1579).
Pendant cette période, l’âge est de 30 ans pour les
filles, et 25 ans pour les garçons.
A partir de 1792 : 25 ans pour les filles, 21 ans
pour les garçons.
A partir de 1803 : 21 ans pour les filles, 21 ans pour les garçons.
A partir de 1974 : 18 ans pour les filles, 18 ans pour les garçons.
CONSENTEMENT
Avant la Révolution
Passé
l’âge de majorité, les futurs conjoints devaient faire « sommations
respectueuses » (avis officiel) aux parents qui n’étaient pas d’accord
avec l’union projetée.
Néanmoins,
le mariage des enfants majeurs sans le consentement des parents et sans
sommations respectueuses n’était pas nul. Les parents pouvaient dans ce cas
déshériter leur enfant.
Après la Révolution
20
septembre 1792 : Pour les moins de 21 ans, le consentement du père est
suffisant, ou a défaut celui de la mère ou du conseil de famille. Au delà de 21
ans la liberté est totale.
Le
Code Civil exige à nouveau le consentement des parents jusqu’à 21 ans et 25 ans
pour les filles et 25 ans et 30 ans pour les garçons. Trois sommations
respectueuses si les parents n’étaient pas d’accord. Valable jusqu’en 1927.
17
juillet 1927 : cette loi classe les futurs époux en trois catégories
-les mineurs de 21 ans pour les
enfants légitimes
*les parents des futurs sont vivants et en état
de manifester leur volonté. Ainsi que pour les parents divorcés :
Ils doivent demander le consentement de leur père et mère. Mais le dissentiment entre le père et mère emporte consentement, c’est-à-dire que si l’un des deux refuse son consentement tandis que l’autre donne le sien, le mariage peut être célébré immédiatement après la constatation du dissentiment. La constatation du dissentiment est faite soit par lettre de ce parent adressée à l’officier de l’état civil et dont la signature est légalisée, soit par un acte authentique de non-consentement dressé dans la même forme qu’un acte de consentement, soit par l’acte même de célébration de mariage.
*le père ou la mère est mort ; ou l’un d’eux est
dans l’impossibilité de manifester sa volonté ; ou est absent ; ou
est disparu (il en est de même pour les deux parents) :
Le consentement de l’un des parents suffit, sinon les descendants directs les remplacent, à défaut le conseil de famille.
~Le décès est prouvé par un acte authentique. Cela n’est pas nécessaire si le père ou la mère du défunt ou le conjoint attestent le décès sous serment.
~L’impossibilité de manifester sa volonté résulte
→ de l’interdiction légale à la suite d’un arrêt de condamnation aux travaux forcés, à la détention ou à la réclusion. L’interdiction légale est établie par la production de l’arrêt de condamnation ou d’un extrait du casier judiciaire. Est assimilée aussi la peine de la relégation ou maintient aux colonies sur l’exécution de la peine des travaux forcés.
→ de l’interdiction judiciaire pour cause d’imbécillité, de démence ou de fureur. Elle est établie par jugement ou l’arrêt la prononçant.
→ de l’internement dans un asile d’aliénés. L’officier de l’état civil doit avoir soin d’annexer à l’acte de célébration du mariage un certificat du directeur de l’asile constatant l’impossibilité où se trouve l’ascendant interné, mais non interdit de manifester sa volonté.
→ de la déchéance de la puissance paternelle prononcée.
~Justification de l’absence ou de la disparition
L’absence est en principe justifiée par la production de l’expédition du jugement qui l’a déclarée, soit du jugement préparatoire qui a ordonné l’enquête. Si le domicile est inconnu et si la personne n’a pas donné de nouvelle depuis un an, il peut être procédé à la célébration du mariage sans justificatif si le conjoint présent en fait serment. Il en est fait mention dans l’acte.
-les mineurs de 21 ans pour les
enfants naturels
Si le futur époux est reconnu seulement par son père ou sa mère, qu’il est vivant et capable de manifester sa volonté, la personne ne peut se marier sans le consentement de celui de ses parents qui l’a légalement reconnu.
Si le futur époux est reconnu à la fois par ses père et mère, qu’ils sont vivants et capables de manifester leur volonté, la personne avoir le consentement des deux parents. Si il y a dissentiment entre le père et la mère ce partage emporte consentement, même si le parent qui donne son consentement n’est pas celui qui exerce la puissance paternelle.
Si le futur époux est reconnu à la fois par ses père et mère, que l’un des deux est mort, ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou absent ou disparu, il suffit que la personne justifie du consentement du parent vivant. La preuve du décès doit être faite par la production de l’acte authentique.
Si le futur époux n’est pas reconnu à la fois par ses père et mère, que les deux sont morts ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou absents ou disparus, la personne ne peut se marier qu’après consentement du conseil de famille.
-les mineurs de 21 ans pour
les enfants adoptés
Le droit de consentir au mariage de l’adopté appartient à l’adoptant et non aux ascendants. Toutefois, en cas d’interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès de l’adoptant survenu pendant la minorité de l’adopté, la puissance paternelle et par conséquent le droit de consentir au mariage, revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
-les mineurs de 21 ans pour
les pupilles de l’Assistance publique
Le consentement est donné par le conseil de famille formé par une commission de sept membres élus par le conseil général du département.
-les majeurs de 21 ans, mais mineurs
de 25 ans pour les enfants légitimes
*les parents des futurs sont vivants et en état
de manifester leur volonté :
Le
futur qui a atteint l’âge de 21 ans
révolus doit
encore en principe, jusqu’à 25 ans
révolus, demander le consentement de ses
père et mère. Si l’un des deux parents
refuse le consentement, le mariage peut
avoir lieu. Si les deux parents refusent le consentement, le mariage ne
peut
être célébré que 15 jours
francs écoulés après la notification
du projet de
mariage qui leur a été faite à la
requête du futur époux par un notaire.
*le père ou la mère est mort ; ou l’un d’eux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ; ou est absent ; ou est disparu (il en est de même pour les deux parents) :
Le mariage ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’ascendant vivant ou à défaut de ce consentement que 15 jours francs écoulés comme si dessus.
*Le père et la mère sont morts ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou absents ou disparus :
Le futur époux peut se marier librement sans avoir à apporter aucun consentement, ses aïeuls fussent-ils encore vivants.
-les majeurs de 21 ans, mais mineurs
de 25 ans pour les enfants naturels reconnus
Mêmes dispositions que ci-dessus.
-les majeurs de 21 ans, mais mineurs
de 25 ans pour les enfants naturels non reconnus
Peuvent se marier librement sans avoir besoin de consentement.
-les majeurs de 21 ans, mais mineurs de 25 ans pour les
pupilles de l’Assistance publique
Mêmes dispositions que pour les mineurs.
-les majeurs de 25 ans
Les futurs peuvent se marier librement sans consentement ni notification d’aucune sorte. Rien dans la rédaction de leur acte de mariage ne doit donc indiquer le consentement de leurs parents, et si ces derniers sont décédés, absents ou disparus, les futurs n’ont pas à produire ni acte de décès, ni justifications d’aucune sorte.
2 février 1933 : conserve le consentement des
parents jusqu’à 21 ans et au delà liberté totale.
5 juillet 1974 : majorité à 18 ans.
OPPOSITION AU MARIAGE
Le
Code Napoléonien précise que les actes de
mainlevée d’opposition à un mariage
seront portés en marge de l’inscription de
l’acte d’opposition, ainsi que sur
le registre des publications de mariage.
Le
droit de former opposition à la
célébration du mariage appartient à
l’une des
deux parties contractantes, le père, la mère et
à défaut les aïeuls et aïeules.
Les oppositions peuvent être faites même si le futur
ou la future sont majeurs.
MENTIONS MARGINALES
18
avril 1886 mention du divorce sur
l’acte de mariage et l’acte de naissance.
Si le mariage a eu lieu à l’étranger, transcription
du jugement faite sur les registres du lieu où les époux avaient leur dernier
domicile, et inscrite en marge de l’acte de mariage si transcrit en France.
ANNULATION DU MARIAGE
Le Droit Canon ne fait pas mention de l'annulation de mariage mais de la nullité de mariage. Le mariage catholique n'est donc jamais annulé, il est constaté nul et la non-consommation ou la consommation du mariage n'ont rien à voir avec ce constat de nullité. La stérilité, l’impuissance ou les liens consanguins entre époux entraînent la nullité.
LE DIVORCE
Alors qu'au début du Moyen-Âge, le divorce était
pratique courante, l'église catholique sacralise le mariage, qui devient une
union sacrée entre deux êtres qui ne peuvent et ne doivent pas se séparer. Le
divorce est très mal vu et sous l'influence de l'église, il est interdit au
concile de Trente.
Avant
la Révolution, le mariage et la vie de famille
étaient presque exclusivement sous la coupe de l’Eglise et
de la loi Canon.
Avant le mariage, la femme était sujette à
l’autorité de son père et cette
autorité est passait au mari en temps opportun, presque à
l’exclusion de
n’importe quelle liberté économique pour la femme.
Le mari avait la pleine
autorité sur sa femme et sur sa richesse. Au mariage, les biens
du mari et de
l’épouse (présents et futurs) étaient
automatiquement combinés, et seul le mari
administrait ce domaine commun, sans consentement de
l’épouse. Le divorce était
inexistant et l’annulation peu fréquente. La
séparation légale n’était possible
qu’en raison de l’abus ou de la diffamation physique.
L’adultère du mari
n’était pas une cause valable pour la séparation,
excepté dans les cas les plus
extrêmes, mais l’adultère de l’épouse
était une cause de séparation. L’épouse
pouvait être détenue dans un couvent pour une
période indéfinie et sa richesse
dédoublée entre ses enfants ou d’autres parents et
le couvent.
Si le mariage n’est qu’un contrat aux yeux de la loi
civile, il doit pouvoir être rompu librement par l’accord des deux
parties : c’est sur ce principe que la loi du 20 septembre 1792 instaure
le divorce. Son préambule fixe les ambitions de la réforme engagée :
« La faculté de divorcer résulte de la liberté individuelle, dont un
engagement indissoluble serait la perte ». Mais cette loi est critiquée
pour son trop grand libéralisme. Les abus et l’anarchie sont dénoncés. Le Code
Civil de 1804 revient sur les excès de cette législation. Ainsi, il restreint
la possibilité de divorcer à la faute, les conditions sont limitées et
pénalisantes pour les époux.
La
Restauration réaffirme
l’indissolubilité du
mariage. Le divorce, considéré comme un
« poison
révolutionnaire »,
est aboli par la loi du 8 mai 1816, dite « loi
Bonald ». La royauté,
de retour au pouvoir, veut « rendre au mariage toute
sa dignité dans
l’intérêt de la religion, des
mœurs, de la monarchie et de la famille ».
La loi convertit en séparation de corps toutes les instances
en divorces
pendantes devant les tribunaux, et arrête tous les actes
faits pour parvenir au
divorce par consentement mutuel.
A partir de 1876, le député Alfred Naquet dépose
successivement trois propositions de loi dans le sens du rétablissement du
divorce pour faute, mais il échoue dans ses tentatives.
La
IIIème République, par la
« loi
Naquet » du 27 juillet 1884 rétablit le
divorce sur le seul fondement de
fautes précises (adultère, condamnation
à une peine afflictive et infamante,
excès, sévices et injures graves), constituant un
manquement graves aux
obligations des époux et rendant intolérables le
maintien du lien conjugal.
Plusieurs autres loi sont à mettre à
l’actif de la IIIème
République : loi
de 1886 sur la procédure de divorce, loi de 1893 qui donne
pleine capacité à la
femme séparée de corps, loi du 15
décembre 1904 qui abroge l’article 298 du
Code Civil qui interdisait le mariage avec le complice
adultère, loi du 6 juin
1908 rendant obligatoire pour le juge la demande de conversion de
séparation de
corps présentée par l’un des
époux trois ans après le jugement de
séparation.
Sous Vichy, la loi du 2 avril 1941 interdit aux
époux mariés depuis moins de trois ans de divorcer.
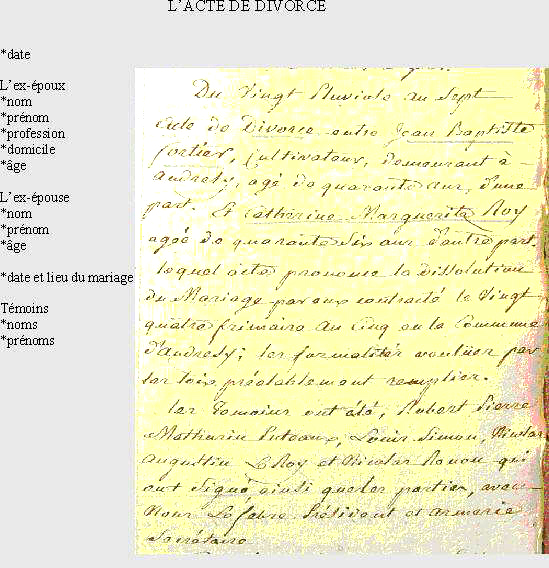
| RETOUR | ACCUEIL |